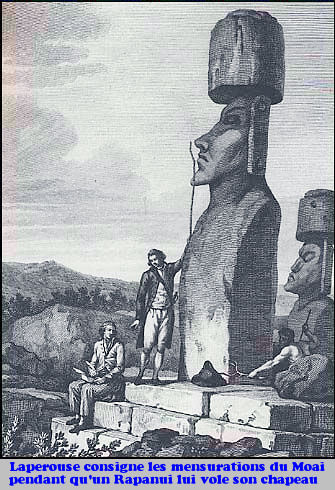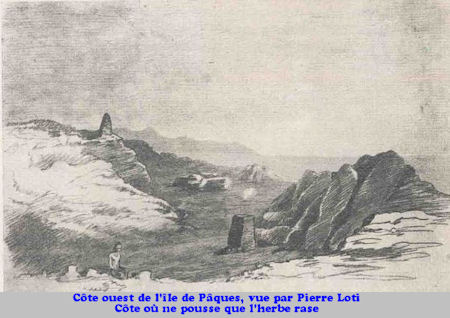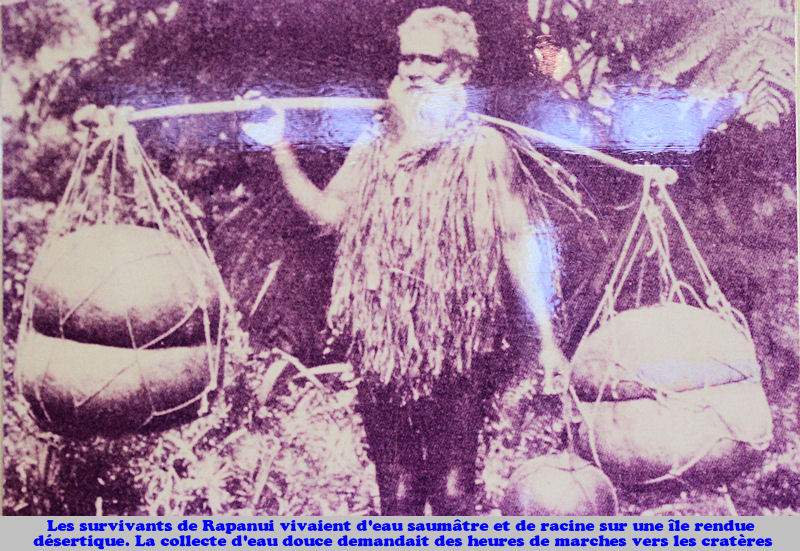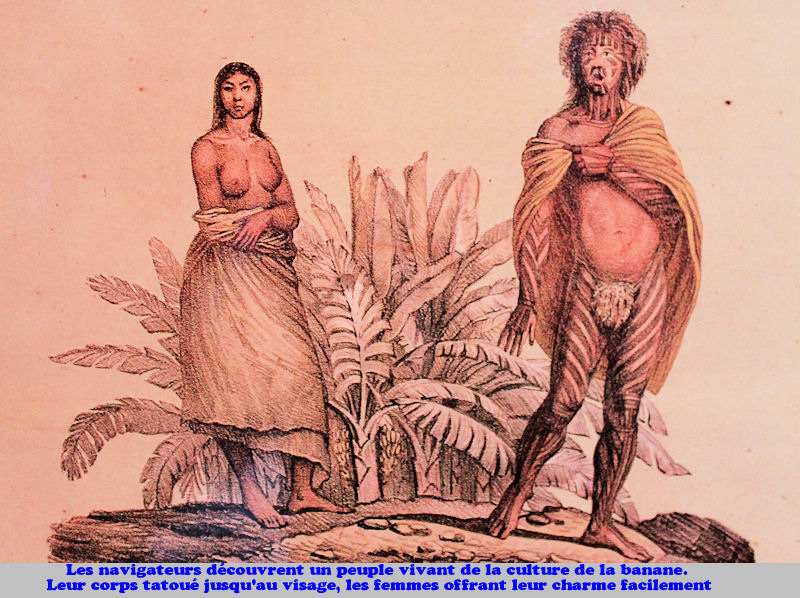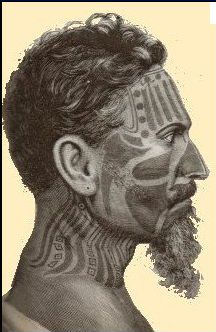 Sommaire
du jour : Sommaire
du jour :
Le déclin de la civilisation mégalithique
Le premier contact avec l'extérieur
Ce qu'il reste de l'île en 1722
Peut-on parler d'écocide ou nom d'une mégalomanie religieuse?
Les Rapanui auraient-ils délibérément scié la branche sur laquelle
ils étaient assis?
Etat des lieux par les navigateurs européens
Fin de message : photos issue du Musée Englert de l'île de Pâques
Bonjour,
Les navigateurs européens du dix-huitième siècle sont les premiers
à rapporter des descriptions de l'île de Pâques. Que ce soit
Roggeveen (1722), Cook (1774) ou Lapérouse (1786), tous voient
d'étranges manifestations mégalithes dressées sur des socles de
pierres sur une terre dépourvue de forêt. Dès lors, l'île de
Pâques devient un point d'escale pour de nombreux navires.
Le déclin de la civilisation mégalithique
Le premier contact avec l'extérieur
La configuration de Rapa Nui, son éloignement de toute autre terre
donnaient, peut-être, la sensation, aux premiers habitants, d'être
"seuls au monde". Lorsqu'en 1722, ils virent le navire de
Roggeveen, malgré les conditions météo dangereuses, les insulaires
n'hésitèrent pas à rejoindre le bâtiment dans leurs frêles esquifs
: "Le temps étant très mauvais et instable avec de l’orage, une
forte pluie et un vent de nord-ouest, le débarquement sur l’île
fut retardé. Le matin suivant le capitaine Bouman vit, venant de
l’île et se dirigeant vers son bateau, une barque avec un homme
complètement nu, ne portant rien sur lui. Celui-ci paraissait très
heureux de nous voir et admirait nos bateaux."
Après plusieurs siècles de "solitude", les Rapanui reprennent
contact avec le reste du monde. Les observateurs consignent ce
qu'ils observent.
Ce qu'il reste de l'île en 1722
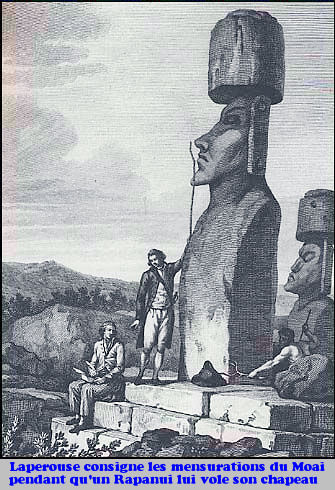
A cette époque, le rite du Moai existe
encore, et Roggeveen le décrit comme suit : "Nous observions
qu’ils faisaient des feux devant de grandes statues de pierre et
qu’ils s’asseyaient sur leurs talons, penchant la tête et levant
et abaissant leurs mains. Ces grandes statues de pierre nous
étonnèrent. Nous ne pouvions comprendre comment ces gens dépourvus
de grosses poutres de bois pour fabriquer quelques dispositifs, et
de même dépourvus de forts cordages avaient pu ériger ces statues,
lesquelles avaient plus de 30 pieds de hauteur avec une épaisseur
en proportion."
Entre 1200 et 1722, la physionomie de l'île a été complètement
bouleversée. La forêt a disparu et les Moai ont été érigés. Sans
arbres, les habitants sont privés de matière capable d'acheminer
leurs gigantesques statues. Si les causes de la déforestation sont
sujettes à controverses, la résultante est immédiate. La
construction des Moai prend fin. Mais, la population fait preuve
d'ingéniosité quant à sa survie. Elle continue, dans un climat
désertique, à cultiver les aliments que les ancêtres avaient
amenés avec eux. Ils plantent les bananiers, la canne, les
différentes racines à l'abri des vents violents qui assèchent
tout. Ils s'ingénient à convertir les tunnels de lave, les grottes
en abri alimentaires.
En outre, les Pascuans ne disposent plus de matières premières
pour construire de grandes pirogues capables de traverser les
océans. Les navigateurs européens s'étonnent de trouver des
pirogues faites comme des puzzles. "En regardant leurs bateaux,
nous les trouvions fragiles étant donné l’usage qu’ils en
faisaient. Leurs petits canots sont faits de petites planches avec
à l’intérieur de légères poutres liées
ensemble avec des fils torsadés faits de la plante déjà nommée «
piet ». Mais comme ils ne connaissaient pas les matériaux pour
calfater leurs barques, ils étaient obligés de faire un grand
nombre de coutures pour imperméabiliser la coque, les rendant
inutilisables pendant un temps assez long. Les canots ont 10 pieds
de longueur et une proue pointue ; leur largeur est telle qu’ils
peuvent juste s’asseoir à l’avant pour pagayer."
La déforestation, outre le manque de matériaux de construction et
de bois de chauffage a entraîné une érosion de la terre, il n'y a
plus guère que les cratères comme réserves d'eau douce, et les
insulaires sont contraints de récolter de l'eau saumâtre filtrée
par le sable. Les premiers navigateurs européens se détournent de
cette terre, où il n'est pas possible pour eux de refaire le plein
d'eau, qu'ils jugent imbuvable.
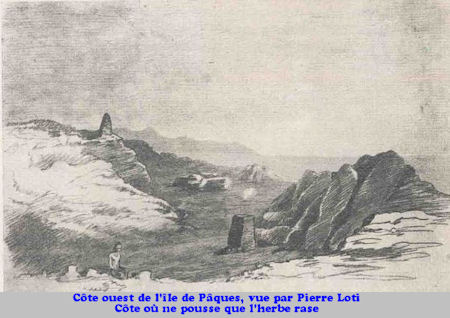
Peut-on parler d'écocide au nom d'une mégalomanie religieuse?
Certaines études parlent d'une hypertrophie religieuse qui aurait
entraîné les ancêtres rapanui au suicide écologique. Ces théories
de déclin programmé permettent à ceux qui les divulguent de mettre
en parallèle le destin des rapanui et celui des humains du vingt
et unième siècle. Hubert Reeves est de ceux qui défendent ce point
de vue : "(...)., les populations ont décliné, la faune et la
flore disparaissaient. Différentes tribus vivaient alors sur l'île
et faisaient en quelque sorte un concours de la plus grosse statue
de pierre, les maois, qui font la notoriété de l'île. Ces statues
nécessitaient de prélever des pierres énormes. De couper les
arbres afin de les transporter jusqu'au site où elles étaient
installées. Bientôt, les habitants n'ont plus eu assez de bois
pour construire des bateaux et pécher. Un scénario catastrophe qui
pourrait se produire à l'échelle de la terre, s'il n'y a pas une
conscience d'environnement assez forte. Il faut tirer les leçons
du passé et savoir prendre des décisions ».
Les Rapanui auraient-ils délibérément scié la branche sur
laquelle ils étaient assis?

La réponse au déclin pascuan est sans doute moins tranchée, plus à
fouiller dans un concours malheureux de circonstances. Il est
probable qu'à l'aune de chaque génération, la déforestation
n'était pas manifeste et consciente. Il est probable également que
le peuple polynésien avait pris dans ses îles d'origine des
habitudes dilapidatrices favorisées par un climat tropical qui
pardonne toutes les erreurs. En effet, sur les îles de Polynésie
(sauf Tuamotu), tout pousse sans trop d'effort, la nature y est
particulièrement prodigue. Les habitudes de ce peuple étaient
incompatibles avec un écosystème moins résistant, plus sujet aux
bouleversements humains et climatiques. Autre grande différence,
avec leurs îles d'origine, chaque parcelle de terrain de Rapa Nui
est accessible, au contraire des vallées inextricables (encore
aujourd'hui) des îles hautes de la Polynésie. Ainsi, la nature
n'avait aucun endroit pour se protéger de l'exploitation humaine.
En outre, certaines études tentent de démontrer que le climat
(successions trop rapides de phénomènes niño ou niña) a lui aussi
provoqué de longues périodes de sécheresse.
Etat des lieux par les navigateurs européens
Entre 1722 et 1786, quatre grandes expéditions s'arrêtent à Rapa
Nui, la première largement abordée, est hollandaise avec
Roggeveen. Puis, les Espagnols abordèrent Rapa Nui en 1770. En
1774, c'est au tour de James Cook et enfin, en 1786 Lapérouse.
En 1722 Roggeveen trouve une population saine et nombreuse : "Ces
gens ont un corps bien proportionné, d’assez grande taille,
paraissant vigoureux et bien musclés. Ces gens ont les dents,
blanches comme de la neige et une bonne dentition. Même les
vieilles personnes aux cheveux gris que nous pouvions observer
croquaient de larges coquilles dures, aussi épaisses que nos
noyaux de pêches." En 1770 les Espagnols venus, de la
vice-royauté du Pérou, estimèrent sa population à 3000 âmes.

En 1774, soit près de cinquante ans après
Roggeveen, Cook, décrit la population comme chétive, ne présentant
pas plus de 600 habitants. Mais il est démenti par Laperouse qui
compte près de 1200 habitants et de bonne constitution. Ce qui est
important dans le témoignage de Lapérouse, c'est son observation
quant au culte des Moai :"Tous ces monuments qui existent
aujourd'hui paraissent fort anciens. On peut douter que la forme
de gouvernement actuel n'ait tellement égalé les conditions qu'il
n'existe pas de chef assez considérable pour qu'un grand nombre
d'hommes s'occupe du soin de conserver sa mémoire en lui érigeant
une statue. On a substitué à ces colosses des monceaux en
pyramide, mausolées qui sont l'ouvrage d'une heure pour une
personne." Sans plus de motivation et de bois, l'un des
navigateurs de passage remarque que les "ahu" ne sont plus
entretenus.
Au dix-huitième siècle, la fin des Moai est largement consommée.
Leur culte sera remplacé par un autre que nous aborderons dans le
prochain épisode.
Note anecdotique : Sur la célèbre photo de
Lapérouse prenant des mesures du Moai, un Rapanui est représenté
en train de lui voler son chapeau. Clin d'oeil des équipages de
l'Astroloabe et de la Boussole au tempérament chapardeur des
Rapanui. Tout comme en Polynésie, tous les navigateurs européens
témoignent de ce comportement, parfois avec agacerie, le plus
souvent avec une certaine tendresse et admiration pour leur
"savoir-faire". Cook en parle en ces termes : "Ils pratiquent le
vol et la tromperie dans les échanges, avec autant de ruse et
d'habileté que tous les autres peuples de ces mers."
A plus, Nat et Dom
www.etoiledelune.net
Sources
Courtoisie : Archives d’Etat de Hollande Journal de Jacob
Roggeveen Découverte de l’île de Pâques.
Article paru dans l'Yonne Républicaine, le lundi 28 août 2006.
Causerie annuelle d’Hubert Reeves à Malicorne
Ecocide de l'île de Pâques : quelle datation et quelle leçon :
…futura-sciences.com
centerblog.net/6069127-exploration et dégradation de l'île
Les manuscrits des anciens – Lorena Bettocchi
JF de Lapérouse "Voyage autour du monde" sur l'Astrolabe et la
Boussole
James Cook Relation de voyages autour du monde
|

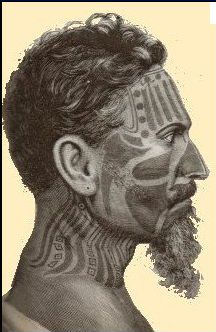 Sommaire
du jour :
Sommaire
du jour :