 Bonjour, Bonjour,
Voici le dernier épisode de cette saga de la Bounty. A croire que
tout ce qui touche ce bateau se transforme inexorablement en fait
extraordinaire...
La Bounty en cin émascope émascope
La Bounty et ses mutinés ont de tout temps attisé l'imagination des
créatifs. Ils intéressent d'abord, les écrivains, dont Jules Vernes
qui écrit en 1879 « Les révoltés de la Bounty », un texte éducatif,
illustré par L. Benett, publié dans la collection « Voyages
extraordinaires » de la Bibliothèque d'éducation et de récréation
des éditions H Hetzel. Puis, en matière de littérature, on connaît
le succès retentissant de la trilogie écrite à quatre mains par
Nordhoff et Hall.
Mais avant qu'ils ne pensent à écrire ce « best-seller », pendant la
Première Guerre mondiale, en 1916, Raymond Longford, un réalisateur
australien sort une première version cinématographique muette
: « the mutiny of the bounty ». Film de 55 minutes où des acteurs
pionniers tels que Gwill Adams, Mere Amohau, défendent la cause de
Christian et soulignent la tyrannie de Bligh.
Dans les années 1930, le sujet est mûr et les réalisateurs le
croquent à pleines dents.
En 1933, alors que « Les révoltés » de Hall et Nordhoff viennent à
peine d'être édités, Charles Chauvel, considéré aujourd'hui comme le
père du cinéma australien, réalise le fim qui a pour titre : « In
the wake of the Bounty ». Errol Flynn y incarne Fletcher Christian,
tandis que Mayne Linton lui donne la réplique dans la jaquette de
Bligh.  Pour la petite histoire, la mère de Flynn était une
descendante de Edward Young. Le second maître à bord de la vraie
Bounty et ami de Christian, qui partit avec lui sur Pitcairn. Il
résista aux attaques des Tahitiens, mais mourut d'un problème
pulmonaire. Il est l'un des fondateurs ayant établi les premières
règles éducatives dans la colonie. Pour la petite histoire, la mère de Flynn était une
descendante de Edward Young. Le second maître à bord de la vraie
Bounty et ami de Christian, qui partit avec lui sur Pitcairn. Il
résista aux attaques des Tahitiens, mais mourut d'un problème
pulmonaire. Il est l'un des fondateurs ayant établi les premières
règles éducatives dans la colonie.
 En 1935,
les Américains s'emparent du sujet. Pour un budget de 2 000 000 de
dollars, Frank Lloyd réalise « Mutiny of the Bounty ». Charles
Laughton, a la tête de l'emploi pour endosser le rôle de l'infâme
Bligh et Clark Gable prend celui Christian Fletcher au grand coeur.
C'est Movita Castaneda, qui lui donne la réplique en tant que
Tehanni, la fille d'un chef indigène de Tahiti. Bizarrerie des
destins croisés : elle sera la seconde femme de Marlon Brando, dont
elle aura deux enfants. En 1935,
les Américains s'emparent du sujet. Pour un budget de 2 000 000 de
dollars, Frank Lloyd réalise « Mutiny of the Bounty ». Charles
Laughton, a la tête de l'emploi pour endosser le rôle de l'infâme
Bligh et Clark Gable prend celui Christian Fletcher au grand coeur.
C'est Movita Castaneda, qui lui donne la réplique en tant que
Tehanni, la fille d'un chef indigène de Tahiti. Bizarrerie des
destins croisés : elle sera la seconde femme de Marlon Brando, dont
elle aura deux enfants.
En 1962, la MGM démarre une super production, dont Marlon Brando est
la « super star ».
Le film dure 3h07, il est d'abord réalisé par Carol Reed, puis
Lewis Milestone prend le relais. Le scénario est largement 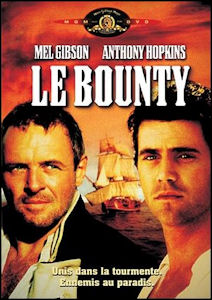 inspiré
du roman de Charles Nordhoff et James Norman Hall. Marlon Brando est
Fletcher Christian, tandis que Trevor Howard joue William Bligh.
Tarita, une Tahitienne engagée sur place est la partenaire de Marlon
Brando. inspiré
du roman de Charles Nordhoff et James Norman Hall. Marlon Brando est
Fletcher Christian, tandis que Trevor Howard joue William Bligh.
Tarita, une Tahitienne engagée sur place est la partenaire de Marlon
Brando.
Cette réalisation bouleversera le quotidien des Tahitiens, ainsi que
celui de Marlon Brando. (Nous y revenons dans la rubrique suivante)
En 1974, un réalisateur italien s'attaque, à son tour, au sujet.
Sous le titre "Noa Noa" The survivors of the Bounty », Hugo
Liberatore tourne en République dominicaine, il ne marque pas
profondément les esprits.
En 1984, une nouvelle équipe de tournage américaine dirigée par
Roger Donaldson débarque à Tahiti. Dans ce film, Mel Gibson donne la
réplique à Anthony Hopkins. Moorea est choisie pour décor. Préservée
et plus sauvage que Tahiti devenue trop urbanisée, elle offre un
décor superbe, qui correspond exactement à l'image féérique qu'ont
véhiculée les marins de passage. Pour cette production, la Bounty a
été reconstruite à l'identique. Elle est, aujourd'hui, conservée au
musée flottant de Sydney.
L'épopée tahitienne autour de la Bounty

Si le premier passage de la Bounty en 1789 ne bouleverse que la vie
d'une dizaine de Tahitiens, son retour en 1960 ne passe pas
inaperçu.
A cette époque, Tahiti vit endormie au coeur du Pacifique. Elle est
possession des Français, mais trop loin, la Métropole s'y fait
discrète. Les insulaires vivent de leur production locale, peu aidés
de la patrie mère. Des Allemands et des Américains se sont
installés, ils ont établi des plantations ou créent du négoce. Ils
prospèrent à leur rythme. Le 15 octobre 1960, marque le grand
tournant de Tahiti. Celui qui bouleversera tout le système de valeur
de la population.
Ce jour, l'équipe de tournage de la MGM débarque à Papeete, avec
tout son clinquant et tous ses millions : 18 en tout.
Pour l'époque cela représente un budget gigantesque. Le bateau a
coûté 750 000 dollars. Le cachet de Brando est de 500 000 dollars,
plus dix pour cent sur les recettes, plus 5000 dollars par jour de
dépassement. Pour la réalisation du film, des centaines de danseurs
et de figurants sont engagés, des tonnes de fleurs sont commandées
chaque jour. A Tahiti, l'argent facile coule à flot. Un pêcheur
reçoit pour quelques coups de pagaies dans sa pirogue, l'équivalent
d'un mois de pêche. Dans la dépêche du Midi, l'on raconte « qu'une
femme qui s'occupa de la confection de colliers de fleurs pour le
tournage, s'acheta à la fin de la superproduction trois maisons! »
Que cela reste entre nous, mais les Tahitiens ont une légère et très
sympathique propension à l'exagération. Malgré cette disposition,
l'on imagine à quel point le tournage du film bouleverse le
quotidien des insulaires.
Sur le tournage, tout n'est pas aussi rose que ce l'est pour Tahiti
qui engrange les millions. Excédé par le comportement erratique de
Marlon Brando, le réalisateur Carol Reed rentre aux Etats-Unis. Est
dépêché, sur place, en tant que remplaçant, Lewis Milestone qui
tourne son dernier  film. La
dernière image révèle toute la démesure du tournage et nécessite 100
kg de glaces (dans un climat torride) afin d'aider Fletcher
Christian à simuler parfaitement les tremblements de son agonie. film. La
dernière image révèle toute la démesure du tournage et nécessite 100
kg de glaces (dans un climat torride) afin d'aider Fletcher
Christian à simuler parfaitement les tremblements de son agonie.
Dès sa sortie en salle, les Américains affluent pour découvrir les
somptueux paysages. Le mythe est réveillé, il ne s'éteindra plus. Tahiti
devient aux yeux du monde, la coqueluche du rêve d'ailleurs, « bien
meilleur que chez soi! » Tahiti
devient aux yeux du monde, la coqueluche du rêve d'ailleurs, « bien
meilleur que chez soi! »
Marlon Brando à Tahiti et Tetiaroa
L'équipe du film a plié bagage, mais Marlon Brando, reste accroché à
Tahiti. Il épouse la belle Tatira avec laquelle il a deux enfants,
dont Cheyenne, qui malheureusement se suicidera après la sordide
affaire d'assassinat de son fiancé par son demi-frère, Christian.
Le nom de Marlon Brando, reste intimement lié à celui de Tahiti, et
à une île toute proche, celle de Tetiaroa. Elle était la résidence
« secondaire » des Pomare. En 1904, les descendants de la famille
royale offrent l’atoll au Dr Johnston Walter Williams. Cet Anglais
était, alors, le seul dentiste de Polynésie. En 1965, Marlon Brando
découvre l'atoll et négocie un bail emphytéotique (pour 99 ans).
En 1966, l'acteur parvient à transformer le bail en achat. Il
acquiert pour la somme de 17 942 000 de XPF (150 000 euros) l'atoll
de Tetiaroa. Il y fait tracer une piste pour petits avions, puis il
fait construire un hôtel tenu par sa femme Tarita. Plus tard, leur
fils en prendra les rênes.
Le 1er juillet 2004, la mort de Marlon Brando sonne le glas de la
tranquillité sur Tetiaroa. L'atoll, avec son hôtel discret, en
matières naturelles n'avait pas défiguré l'environnement. Le respect
de la faune et de la flore terrestres et aquatiques était roi. Mais
la succession découvre des charognards qui rôdent.

Les autorités polynésiennes, parties prenantes dans la succession,
ne respectent pas les désirs de Brando de laisser l'atoll
« propre ». Elles cèdent aux offres d'un habitué du tourisme à
Tahiti, Richard Bailey, il fait main basse sur l'île aux oiseaux de
Brando. A l'heure actuelle, il y déploie à coups de bulldozers une
structure hôtelière de luxe "propre". Un « Eco-Resort de luxe" sous
le nom de "The Brando".
Le résultat aura sans doute des allures « propres », mais la
construction a déjà bel et bien détruit une partie du récif
corallien...
A plus, pour poursuivre ce tour de l'île par le petit bout de la
lorgnette
Nat et Dom
www.etoiledelune.net
|

 Bonjour,
Bonjour,
 émascope
émascope Pour la petite histoire, la mère de Flynn était une
descendante de Edward Young. Le second maître à bord de la vraie
Bounty et ami de Christian, qui partit avec lui sur Pitcairn. Il
résista aux attaques des Tahitiens, mais mourut d'un problème
pulmonaire. Il est l'un des fondateurs ayant établi les premières
règles éducatives dans la colonie.
Pour la petite histoire, la mère de Flynn était une
descendante de Edward Young. Le second maître à bord de la vraie
Bounty et ami de Christian, qui partit avec lui sur Pitcairn. Il
résista aux attaques des Tahitiens, mais mourut d'un problème
pulmonaire. Il est l'un des fondateurs ayant établi les premières
règles éducatives dans la colonie.  En 1935,
les Américains s'emparent du sujet. Pour un budget de 2 000 000 de
dollars, Frank Lloyd réalise « Mutiny of the Bounty ». Charles
Laughton, a la tête de l'emploi pour endosser le rôle de l'infâme
Bligh et Clark Gable prend celui Christian Fletcher au grand coeur.
C'est Movita Castaneda, qui lui donne la réplique en tant que
Tehanni, la fille d'un chef indigène de Tahiti. Bizarrerie des
destins croisés : elle sera la seconde femme de Marlon Brando, dont
elle aura deux enfants.
En 1935,
les Américains s'emparent du sujet. Pour un budget de 2 000 000 de
dollars, Frank Lloyd réalise « Mutiny of the Bounty ». Charles
Laughton, a la tête de l'emploi pour endosser le rôle de l'infâme
Bligh et Clark Gable prend celui Christian Fletcher au grand coeur.
C'est Movita Castaneda, qui lui donne la réplique en tant que
Tehanni, la fille d'un chef indigène de Tahiti. Bizarrerie des
destins croisés : elle sera la seconde femme de Marlon Brando, dont
elle aura deux enfants. 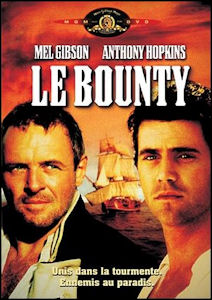 inspiré
du roman de Charles Nordhoff et James Norman Hall. Marlon Brando est
Fletcher Christian, tandis que Trevor Howard joue William Bligh.
Tarita, une Tahitienne engagée sur place est la partenaire de Marlon
Brando.
inspiré
du roman de Charles Nordhoff et James Norman Hall. Marlon Brando est
Fletcher Christian, tandis que Trevor Howard joue William Bligh.
Tarita, une Tahitienne engagée sur place est la partenaire de Marlon
Brando. 
 film. La
dernière image révèle toute la démesure du tournage et nécessite 100
kg de glaces (dans un climat torride) afin d'aider Fletcher
Christian à simuler parfaitement les tremblements de son agonie.
film. La
dernière image révèle toute la démesure du tournage et nécessite 100
kg de glaces (dans un climat torride) afin d'aider Fletcher
Christian à simuler parfaitement les tremblements de son agonie. Tahiti
devient aux yeux du monde, la coqueluche du rêve d'ailleurs, « bien
meilleur que chez soi! »
Tahiti
devient aux yeux du monde, la coqueluche du rêve d'ailleurs, « bien
meilleur que chez soi! »